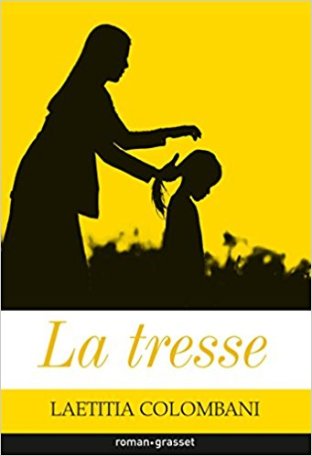Le roman s’ouvre sur une scène glaçante : celle d’une famille, la mère, le père, l’enfant dans sa chaise haute, empoisonnés. La mère et l’enfant sont morts. Le père est évacué, en urgence, entre la vie et la mort. La mère de famille est l’empoisonneuse. Et l’on comprend d’emblée que ce geste désespéré est la conséquence d’un autre drame, le seul drame de la vie de cette femme mais « suffisamment fort pour passer à l’acte »…
Passé ce préambule choc, l’auteure remonte le cours du temps et nous ramène, avec ses personnages, au temps de l’innocence. Avant le drame. Avant la descente aux enfers. Avant l’inéluctable meurtre.
Marie et Laurent forment un couple heureux, de ceux que l’on qualifie même d’idéal. Leur bonheur est parfait, leur vie maîtrisée. D’ailleurs, Marie « n’a jamais éprouvé la sensation de perdre un seul instant la maitrise de sa vie. » Elle travaille dans une banque comme gestionnaire de patrimoine ; il est avocat dans un grand cabinet où il gère divorces et successions. Ils habitent le 11ème arrondissement. « Marie est consciente qu’elle n’a jamais eu besoin de lutter pour s’en sortir (…) Elle ne peut réellement comprendre les dérives de l’âme. » Quand ils décident d’avoir un enfant, Marie se représente aussitôt le tableau idéale de la famille parfaite : les repas du dimanche chez ses parents, les promenades au Jardin du Luxembourg, elle en mère aimante et attentionnée…
Mais cette vie trop lisse et trop parfaite se fracasse en quelques minutes, un vendredi soir, dans la voiture de son directeur général : « Au coeur de la nuit, face au mur qu’elle regardait autrefois, bousculée par le plaisir, le malheur du bas lui apparait telle la revanche du destin sur les vies jugées trop simples. » Le malheur du bas est un viol. Minutieusement, douloureusement, crûment décrit sur cinq pages. Et après ce viol, « Marie ne se dit pas que c’est fini. Elle sait que ce n’est que le début. » Et dès la première personne croisée dans son immeuble, elle sait aussi, déjà, « qu’elle est en train de dissimuler le mal, qu’elle ne dira rien, que personne ne sera jamais au courant de cette agression.« Son mari dînait avec un client ce soir-là. Marie se douche, se couche, fait semblant de dormir lorsqu’il rentre. Elle « sait qu’elle va devoir faire semblant de vivre et de dormir pendant de nombreux jours. »
Et la vie reprend son cours dès le lendemain matin. Tout juste Marie semble-t-elle un peu fatiguée, un peu absente. Elle part travailler, déjeune avec un collègue, rentre se préparer avant d’aller dîner chez un couple d’amis. Lui est gynécologue, il fait le récit terrifiant d’une jeune fille battue et violée par son père. Marie voudrait « hurler qu’elle aussi s’est fait violer par son patron » mais « elle ne se sent pas assez courageuse. Elle a peur de tout détruire, de perdre son mari et ses amis, qu’on la juge, qu’on la soupçonne de mentir, d’exagérer. Elle renonce. » Elle se sent sale et honteuse, même si c’est elle la victime. Alors elle se tait.
Même chose chez ses parents, tout à la joie d’apprendre que Marie et Laurent envisage d’avoir un enfant… Le tableau familial reste idyllique – en apparence : « dans ce tableau sans défauts visibles, il faut s’arrêter sur les détails. Personne n’a l’idée de le faire. Ils préfèrent la douce et rassurante surface des sentiments, lisse et souple, ne surtout pas discerner les taches noires, les dysfonctionnements. » Et Marie se retrouve prise au piège du mensonge de l’idéalisme. Et même si tout devient de plus en plus compliqué au fil des jours, la vie continue, sans trêve, sans répit, sans concession. Marie a choisi le silence et elle en paye le prix, à chaque instant.
Et comme si le malheur du bas, la douleur intime, la souffrance psychologique ne suffisaient pas, Marie tombe enceinte. Son mari est fou de joie ; elle est anéantie, persuadée au plus profond d’elle-même que cet enfant est le fruit de son viol. Mais là encore, pour ne pas troubler l’image du bonheur parfait, elle se tait encore, sourit, accouche, tente de tenir sa place de mère et « chacun tient son rôle dans cette comédie absurde. » La honte, toujours la honte, omniprésente, envahissante, paralysante.
Et l’on assiste, aussi impuissants que Marie, malgré son impression de maîtrise, à sa descente aux enfers : « elle est l’actrice principale. Elle est la victime qui sait tout. Jamais elle ne laissera son histoire être entièrement dévoilée. Elle ne mérite pas de tout perdre maintenant. » Elle s’accroche à cette idée, désespérément. Mais « l’espace du mensonge se referme sur elle« , elle est piégée dans un engrenage terrible, celui de devoir « tout dissimuler derrière les apparences« , continuer comme si de rien n’était. Jusqu’à l’impossible. Jusqu’au jour où elle se dit qu’elle doit « arrêter l’histoire elle-même » et que son geste n’en sera que la fin logique.
Magistralement construit, implacablement mené de bout en bout, le premier roman d’Inès Bayard se lit comme un thriller conjugal et familial, aussi réaliste qu’effarant, aussi bouleversant qu’oppressant, aussi ténu que puissant. L’écriture est précise, ciselée, crue, les mots choisis, brutaux, exacts, pour dire la douleur, le mensonge, le déni, la violence, l’incompréhension, l’aveuglement : ils sont les mots que Marie ne parvient pas à prononcer, les mots étouffés qu’elle retient en elle jusqu’à ne plus envisager que la mort pour s’en délivrer. « Elle était enfin devenue la femme de la situation. Une de celles qui parviennent à maîtriser leur propre histoire.«
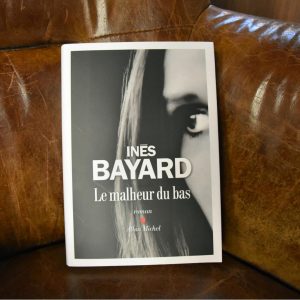






 Colum McCann est né en 1965 à Dublin et vit aujourd’hui à New York. À dix-neuf ans, il quitte l’Irlande pour les États-Unis, où il exercera divers métiers – chauffeur de taxi, professeur, guide de randonnée, journaliste et reporter. Lauréat des prestigieux prix de littérature irlandaise Hennessy (1992) et Rooney (1994) pour ses nouvelles, il est l’auteur de deux recueils :
Colum McCann est né en 1965 à Dublin et vit aujourd’hui à New York. À dix-neuf ans, il quitte l’Irlande pour les États-Unis, où il exercera divers métiers – chauffeur de taxi, professeur, guide de randonnée, journaliste et reporter. Lauréat des prestigieux prix de littérature irlandaise Hennessy (1992) et Rooney (1994) pour ses nouvelles, il est l’auteur de deux recueils :